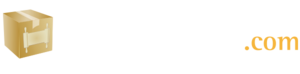Bonjour Rav,
Étant une jeune fille de 19 ans, on me parle beaucoup de mariage quand je vais à des cours. Cela me laisse avec certaines réticences et questionnements concernant :
- Mon argent qui appartient à mon mari : est-ce que cela signifie que je dois lui demander avant de faire un achat quel qu’il soit ? Coûteux ou non ? Pour une Mitsva / du ‘Hessed (ex: cadeau à ma mère, Tsédaka, acheter de belles choses pour les fêtes…) ? Pour quelque chose en lien avec le foyer (ex: rendre la maison plus agréable…), ma qualité d’épouse (ex: de quoi m’embellir pour lui…) ou pour mes enfants (cadeaux spontanés…) ? Si c’est simplement un plaisir personnel (si je veux inviter une amie pour un après-midi au spa par exemple) ? Apparemment, je peux récupérer la propriété sur l’argent que j’ai fait gagner à mon mari, mais pour cela je dois dire qu’il n’a plus à s’acquitter de ses devoirs. Cela concerne-t-il tous ses devoirs ou seulement ses devoirs financiers ?
- L’adoption des coutumes du mari : mon père est décédé quand j’étais très petite et ça me coûte de devoir me séparer de ses coutumes… Y a-t-il des points où c’est plus « souple » à ce niveau-là ?
- Le mari en tant que chef de famille : en quoi cela va-t-il m’impacter moi ou mes enfants ? Peut-il me forcer à faire ou à ne pas faire certaines choses ? Et concernant l’éducation des enfants, a-t-il le dernier mot ? Doit-il au moins m’écouter et prendre vraiment en compte mon avis avant de décider ? Y a-t-il des cas où ma décision a plus de poids que la sienne (comme avec Sarah Iménou qui renvoya Ichma'ël et où Hachem dit à Avraham Avinou d’écouter tout ce que lui dirait Sarah) ? Vous entendrez qu’on ne peut pas connaître à 100% l’autre avant le mariage (et qu’il change avec le temps) et que si, ‘Has Véchalom, j’épouse un homme avec de mauvaises Midot, ce point me fait particulièrement peur.
- La femme en tant que maîtresse de maison: qu’est-ce que cela implique exactement ? Quelles sont les responsabilités et les avantages qui en découlent ? Aussi, est-ce que je peux déléguer certaines tâches ? À qui (mari, enfants, personnel…) ? Si je suis par exemple malade, est-ce que le travail à la maison peut être réparti de manière plus égalitaire ? Aussi, si je délègue à mon mari certaines tâches, y en a-t-il qui sont mieux à déléguer (comme le repassage par exemple où il peut facilement se concentrer sur un cours de Torah (vidéo/podcast…) en parallèle, des tâches rapides… ?
Il me semble que c’est tout. C’est beaucoup en effet, mais je vous en serais très reconnaissante si vous répondez à toutes mes questions.
Merci Rav.
Réponse de Rav Avraham GARCIA
Chalom Ouvrakha,
Vous posez des questions très profondes et très matures. Il est tout à fait normal — et même sain — de vouloir comprendre ce qu'implique le mariage selon la Torah. Pour vous répondre pleinement, je devrai presque vous écrire un livre, mais on va essayer de donner un résumé clair.
1. L'argent dans le couple
La Halakha prévoit un cadre juridique : l'argent gagné par la femme entre dans le patrimoine du foyer, administré par le mari.
Mais les Rabbanim expliquent que dans la pratique, un foyer juif fonctionne sur la confiance, le dialogue et la coopération, et non sur une forme de contrôle.
La structure halakhique est un
cadre minimum, établi pour protéger en cas de litige — c'est la même logique que celle de la Kétouba, qui fixe par écrit les obligations mutuelles du mari et de la femme afin de sécuriser le foyer dans les cas extrêmes.
Dans un foyer équilibré :
- chacun fait ses dépenses habituelles sans demander la « permission » ;
- les dépenses pour la maison, les enfants, les Mitsvot, la Tsédaka raisonnable, se font naturellement ;
- le mari n’a aucun droit d’exiger un contrôle humiliant ou infantilisant.
Les décisionnaires écrivent que tout doit être fait « Kédérekh Bné Adam », selon la norme sociale (Kitsour Pisské Haroch, Guitin 9, 15).
2. Les revenus de la femme
Vous évoquez le droit pour la femme de conserver son revenu. En effet, la Halakha prévoit un mécanisme où la femme peut stipuler que son salaire lui reste personnel (Choul’han 'Aroukh Even Ha'ézer 69, 6).
En échange, le mari n’a plus certaines obligations financières envers elle.
Mais ce mécanisme ne concerne que l’argent.
Les autres devoirs du mari - respect, protection, considération - restent inchangés.
Aujourd’hui, ce dispositif est peu utilisé : les couples organisent leurs finances d’un commun accord, de manière plus souple que ce que décrit la forme halakhique "brute", qui fut établie, comme dit plus haut, pour les cas extrêmes.
3. Les coutumes (Minhaguim)
Classiquement, une femme mariée adopte les coutumes de son mari.
Toutefois, les Poskim signalent des domaines souples : certaines coutumes personnelles, affectives ou familiales peuvent être conservées lorsqu’elles ne contredisent pas le respect du foyer.
Dans des cas émotionnels forts, par exemple des pratiques liées à un parent décédé, beaucoup de Rabbanim cherchent une solution respectueuse (Ma'assé Rav tome 4-59, tome 6-37).
Même la version de la prière (ashkénaze ou séfarade) peut parfois être conservée, puisqu’elle se dit en silence (Ma'assé Rav tome 8-20).
En pratique, on discute de tout cela avant le mariage. Le 'Hatan peut très bien accepter que son épouse conserve certaines coutumes de son père.
Le but n’est pas « d’effacer » la femme, mais d’assurer l’harmonie du foyer.
4. Le mari comme "chef de famille"
La Torah ne parle jamais de domination.
Le mari porte une
direction générale : responsabilité, initiative, souci matériel et émotionnel de la famille.
La femme, quant à elle, est la
maîtresse de maison, c’est-à-dire la directrice intérieure du foyer, celle qui donne le rythme, l’atmosphère, l’organisation.
En aucun cas le mari ne peut exiger quelque chose d’humiliant, contraire à la Halakha ou destructeur psychologiquement.
Il doit écouter, respecter, prendre en compte l’avis de son épouse.
5. L’éducation des enfants
Les deux parents éduquent ensemble [voir commentaires sur Siman 343].
Les Poskim écrivent que le père doit prendre en compte l’avis de la mère (Zekher Naftali 5 ; Lev Eliahou Vaye’hi 208, etc.).
Le mari n’a pas automatiquement « le dernier mot ».
Souvent, la femme a même plus de poids :
• quand son intuition sur les enfants est plus fine,
• lorsqu’il s’agit de l’organisation du foyer,
• lorsqu’elle perçoit un danger émotionnel ou moral.
L’exemple de Sarah Iménou n’est pas unique : nos Maîtres en déduisent la "supériorité" parfois nécessaire de la voix de la femme (Méguila 14a, Béréchit Rabba 47-1, etc.).
On rapporte également l’exemple de On ben Pélet, sauvé par les conseils de son épouse (Sanhédrin 110a).
Nos Sages citent d’ailleurs Michlé 14,1 : « La femme sage construit son foyer ».
Et ils ajoutent que pour ce qui touche à la gestion matérielle de la maison, la femme a priorité (Baba Metsi'a 59a ; Doudaé Reouven 5 ; Vayomer Eliahou Béréchit Drouch 4).
6. Les Midot (qualités) du mari
Vous demandez : "et si, 'has Véchalom, le mari a de mauvaises Midot ?
Le mariage n’est jamais un abandon entre les mains d’un homme dur ou colérique.
La Halakha dit clairement :
• un mari doit être respectueux, doux et attentif (Yebamot 62b ; ‘Houlin 84b).
• Une femme n’est pas tenue de vivre sous pression.
• En cas de comportement nuisible, la halakha protège la femme.
Le mari doit même devancer son épouse et s’efforcer d’être meilleur (Rachi, Lekh Lekha 12-8).
7. La femme comme "maîtresse de maison"
Ce terme n’a rien d’un rôle servile.
Les décisionnaires expliquent qu’il signifie la direction intérieure du foyer :
• atmosphère,
• chaleur,
• organisation quotidienne.
La femme gère la vie familiale, crée l’ambiance spirituelle et émotionnelle du foyer, et reçoit une grande autonomie dans la gestion de la maison.
Elle peut tout à fait déléguer :
• au mari,
• aux enfants selon leur âge,
• à une aide extérieure si nécessaire.
Si elle est malade, la Halakha est explicite : elle n’est pas tenue aux tâches.
Le mari doit soutenir, aider et prendre soin d’elle (Michna Ketouvot 51a ; Choul’han Aroukh Even Ha'ézer 79, 1).
Chaque couple répartit les tâches selon sa personnalité — vaisselle, courses, enfants, etc.
Ce qui compte : accord mutuel et bonne volonté.
Conclusion
Vos questions sont légitimes. Mais ce que la Torah enseigne est très clair : le mariage juif ne demande pas une soumission aveugle de la femme. Il repose sur le respect, l’écoute, la coopération et la construction d’un foyer harmonieux.
Un bon mari est celui qui :
• vous écoute,
• vous protège,
• vous considère,
• cherche votre bien-être matériel, émotionnel et spirituel.
N’ayez donc aucune crainte :
vous êtes protégée, et la Torah veille sur vous.
Kol Touv.